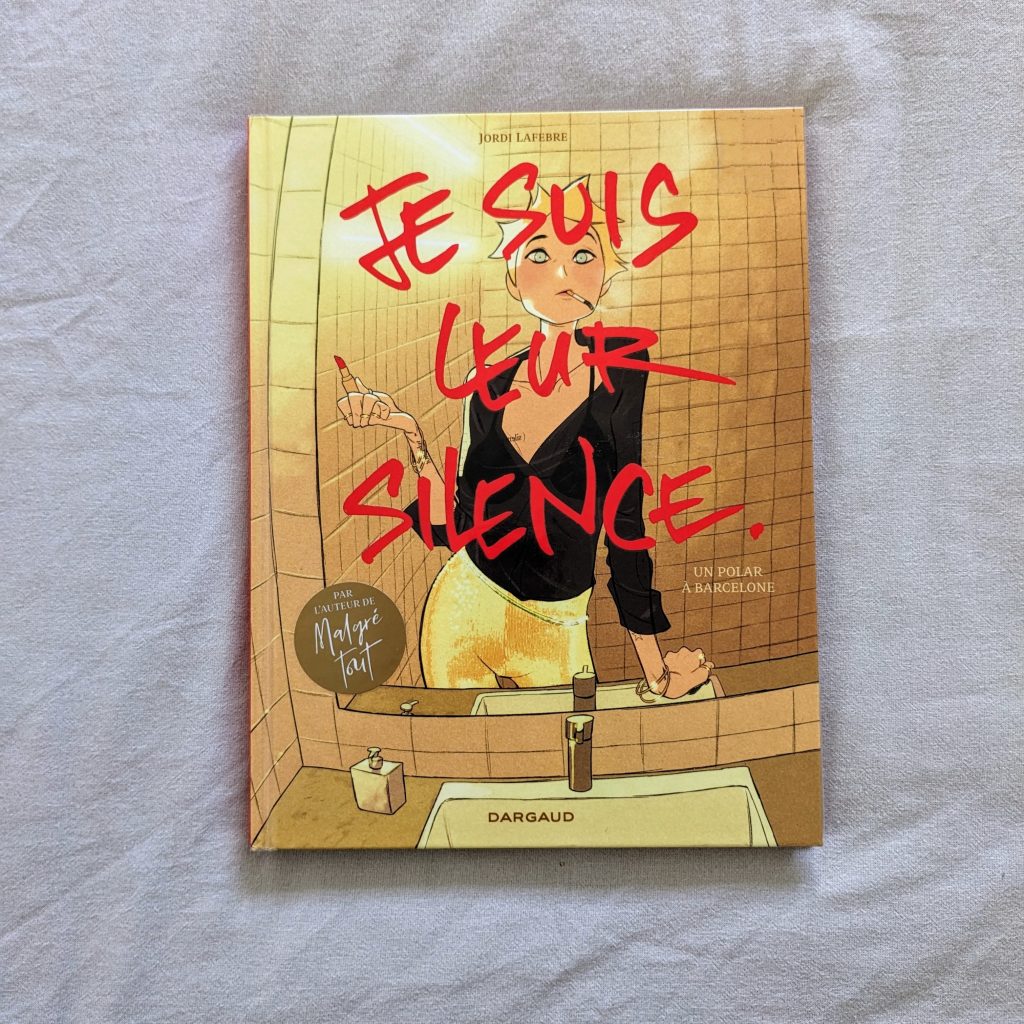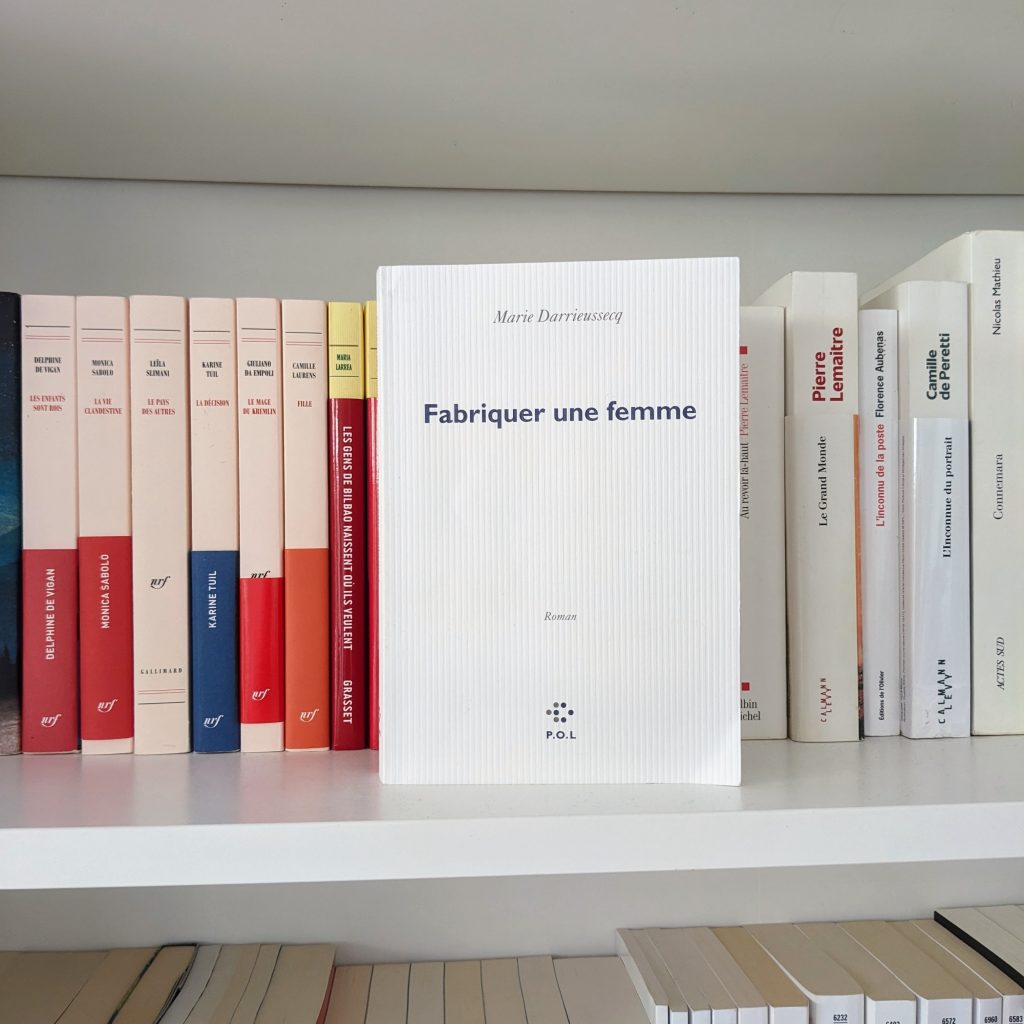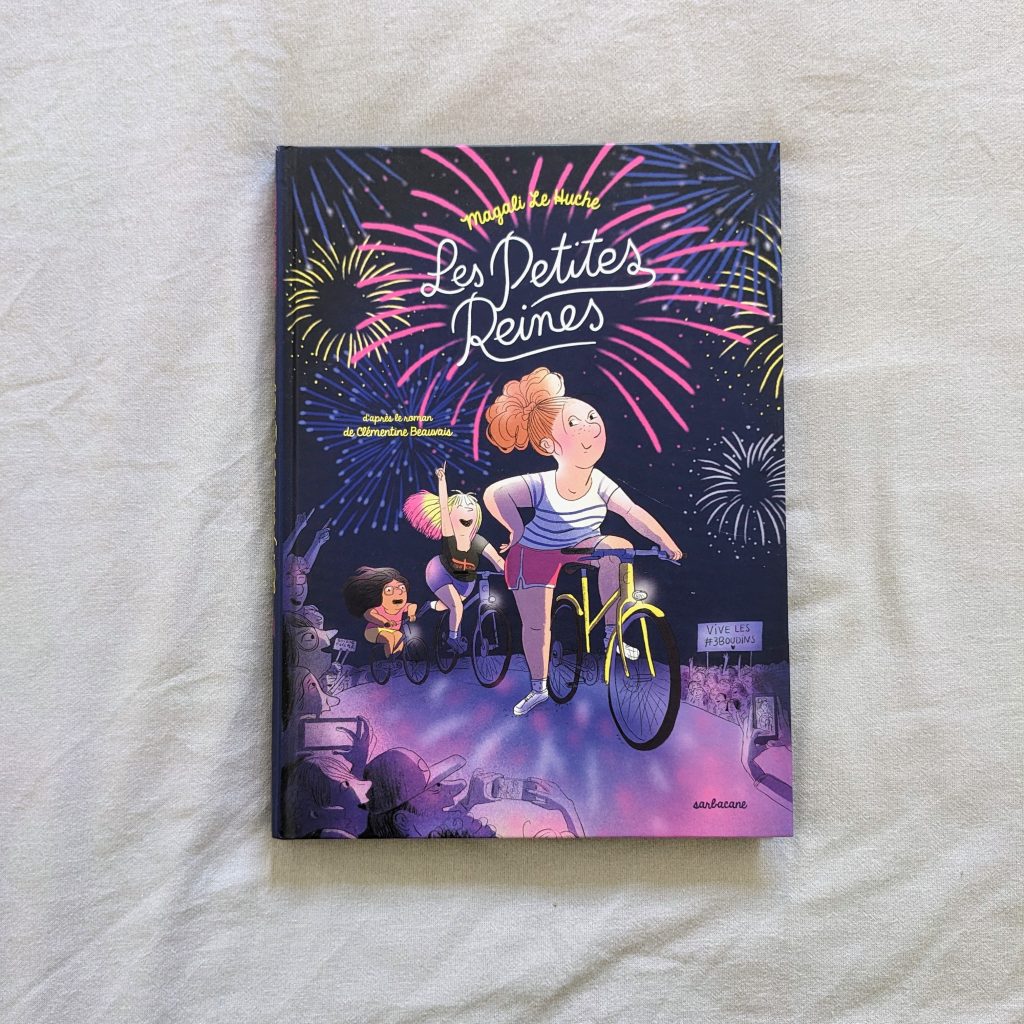Pour l’édition de juin de Les classiques c’est fantastique organisé par Moka, le thème était Tout plaquer ! Introspection, solitude et isolement. Comme j’avais déjà passé Une année à la campagne pour l’édition de mai consacrée à la nature, j’ai décidé cette fois de rester en ville avec L’attrape-cœurs de J.D. Salinger, publié en 1951.
Holden Caufield est un adolescent de 16 ans qui vient d’être renvoyé de son pensionnat huppé, juste avant les vacances de Noël. Après s’être battu avec son camarade de chambre, il s’enfuit de son collège mais préfère errer dans les rues de New-York plutôt que de rentrer chez lui et d’affronter ses parents.
Tout le roman de Salinger repose sur le personnage d’Holden, adolescent torturé qui n’aime rien ni personne, et qui n’arrive pas à trouver sa place. Traumatisé par la perte de son jeune frère, décédé d’une leucémie, Holden est perdu entre l’enfance et l’âge adulte. Pendant trois jours il erre de bar en bar, de souvenir en souvenir, essaye d’appeler quelques connaissances, fait des rencontres au hasard de ses pérégrinations, mais personne n’arrivera à le sortir de sa profonde solitude et de la dépression dans laquelle il s’enfonce.
L’attrape-cœurs est un roman sombre, l’appel à l’aide d’un ado qui grandit dans un monde qu’il perçoit triste et sans espoir. Holden est plutôt agaçant : il s’exprime grossièrement (le style brut et familier a déplu à plus d’un lecteur), et surtout il a un avis très arrêté et négatif sur tout ce qui l’entoure. Il n’a aucun filtre non plus dans sa relation aux autres, ce qui complique ses relations amicales ou amoureuses. Pourtant on ne peut s’empêcher de s’attacher à lui au fil des pages.
Un livre culte, sans doute parce que la colère et le désespoir qui se dégagent de ces pages ont dû parler à nombre d’adolescents au fil des décennies.
L’attrape-cœurs de J.D. Salinger, éditions Robert Laffont / Pavillons Poche, 256 pages