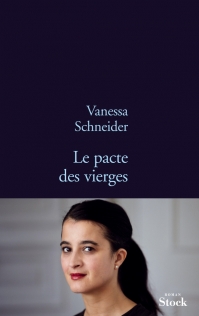 Pour écrire Le pacte des vierges, Vanessa Schneider s’est inspiré d’un fait divers survenu en 2008 dans l’Amérique profonde. 17 adolescentes de Gloucester, un patelin du Massachusetts, fréquentant le même établissement scolaire, étaient tombées enceintes suite à un « pacte ». Quatre d’entre elles, Lana, Cindy, Kylie et Sue, acceptent de se confier à une romancière française. A travers leurs témoignages croisés on découvre comment elles en sont arrivées à mettre en place ce projet fou et absurde.
Pour écrire Le pacte des vierges, Vanessa Schneider s’est inspiré d’un fait divers survenu en 2008 dans l’Amérique profonde. 17 adolescentes de Gloucester, un patelin du Massachusetts, fréquentant le même établissement scolaire, étaient tombées enceintes suite à un « pacte ». Quatre d’entre elles, Lana, Cindy, Kylie et Sue, acceptent de se confier à une romancière française. A travers leurs témoignages croisés on découvre comment elles en sont arrivées à mettre en place ce projet fou et absurde.
Au fil des pages la romancière et son lecteur essayent d’assembler les pièces du puzzle. Toutes âgées de moins de 16 ans, ces jeunes filles ont déjà tout vu, tout vécu. La majorité d’entre elles ont grandi avec un entourage familial défaillant, des parents démissionnaires qui n’assument plus leur rôle, absents, en prison, alcooliques, ou accro aux médicaments (Cochez la case correspondante à votre situation). Ou au contraire pour Sue, des parents puritains, exigeants et étouffants. Ajoutez à ça l’oisiveté, et la précarité dans une petite ville frappée de plein fouet par le chômage. Un terreau plus que favorable pour que des jeunes filles influençables, livrées à elles-mêmes, se laissent convaincre par ce projet dément imaginé par la meneuse de la bande, Lana.
J’ai été à la fois consternée par la folle décision de ces gamines, et émue par leur fragilité et leur naïveté. Ces quatre adolescentes brandissent leur grossesse comme un étendard, elles pensent avoir trouvé là l’opportunité de changer de vie : Elles vont élever leurs enfants ensemble, se créer une nouvelle famille, de nouveaux repères. Faire mieux que leurs parents. Il y a tellement d’espoir dans ces grossesses, l’espoir d’un lien indéfectible que rien ne pourra briser, l’espoir de ne plus jamais être seules. Au fur et à mesure que leurs grossesses avancent, elles comprendront malheureusement que les choses ne sont pas aussi simples.
Cette histoire est effrayante, fascinante, mais le roman ne parvient pas à transcender le fait divers. En sait on vraiment plus quand on tourne la dernière page ? Les caractères manquent de consistance, l’angle choisi (ne donner la parole qu’aux jeunes filles) m’a paru souvent réducteur. L’auteur cherche en plus à créer un suspens artificiel et sans beaucoup d’intérêt autour de quelques éléments secondaires (des rendez-vous dans une vieille caravane près de la voie ferrée, le rôle d’un mystérieux « John »). Au fond c’est le fait divers qui est passionnant ici, bien plus que le roman lui-même, et il aurait sans doute mérité mieux que cet habillage un peu trop léger.
Editions Stock 2011, 190 pages/ ![]()
Lu dans le cadre des matchs littéraires organisés par Price Minister.
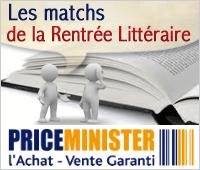
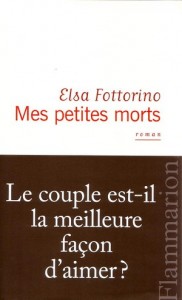

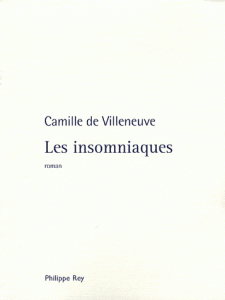
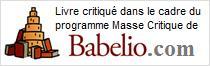
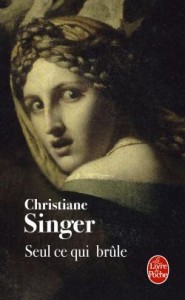 “Il vit sortir de derrière la tapisserie une femme, la plus belle qu’il était possible de regarder mais elle avait la tête toute tondue, le demeurant du corps habillé de noir… Elle alla s’asseoir au bout de la table, sans parler à nulluy et ny nul à elle. Après qu’elle eut mangé un peu, elle demanda à boire, ce que lui apporta un serviteur, dans un émerveillable vaisseau, car c’était la tête d’un mort dont les yeux étaient bouchés d’argent…”
“Il vit sortir de derrière la tapisserie une femme, la plus belle qu’il était possible de regarder mais elle avait la tête toute tondue, le demeurant du corps habillé de noir… Elle alla s’asseoir au bout de la table, sans parler à nulluy et ny nul à elle. Après qu’elle eut mangé un peu, elle demanda à boire, ce que lui apporta un serviteur, dans un émerveillable vaisseau, car c’était la tête d’un mort dont les yeux étaient bouchés d’argent…”